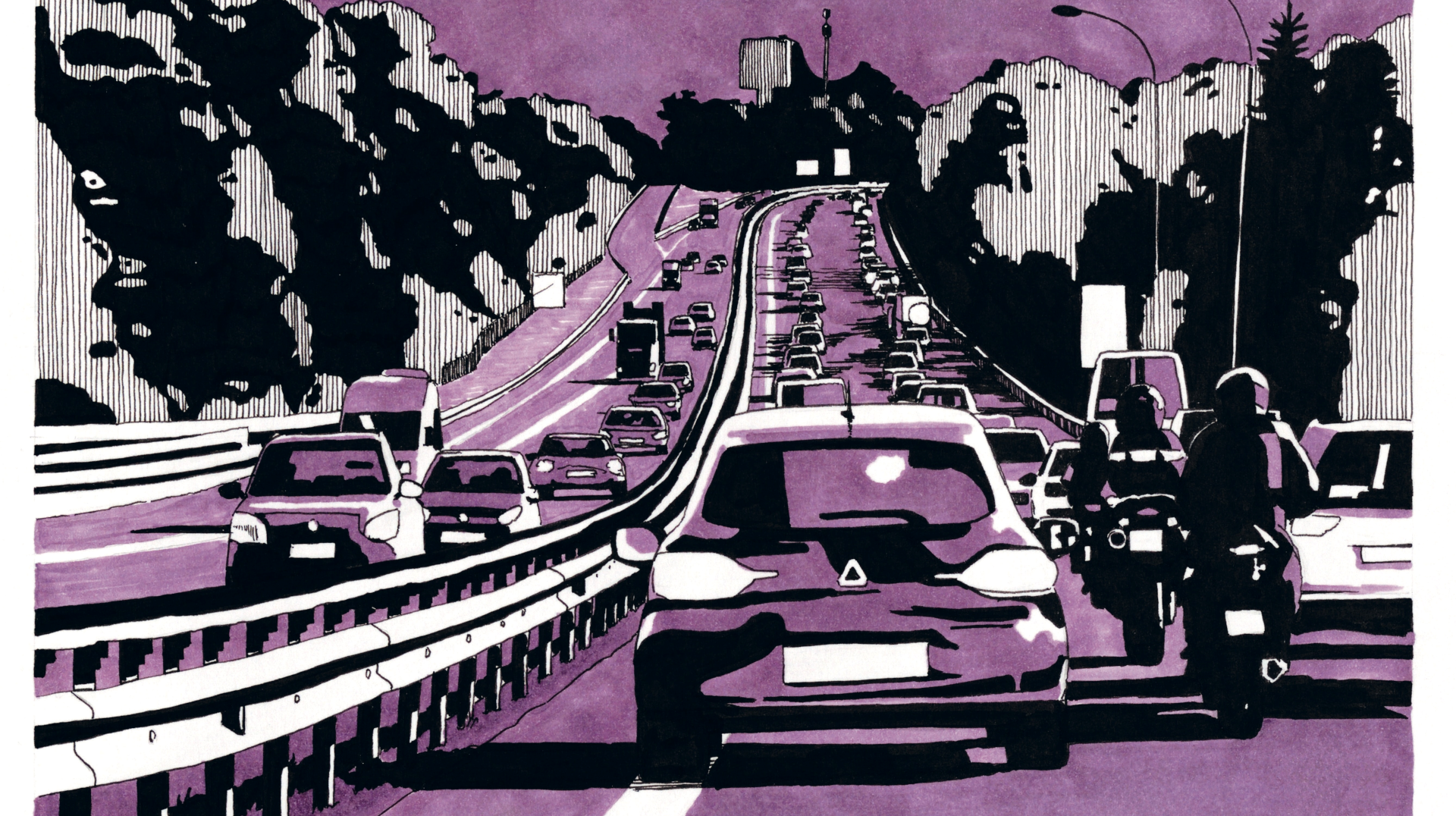En septembre 2025, j’ai publié Temps de trajet (Point Nemo Publishing), un roman graphique réalisé en collaboration avec le dessinateur Charl Vinz. Cet ouvrage s’appuie sur une enquête de terrain menée pendant une année, mobilisant des approches issues de la sociologie et de l’anthropologie. Nous avons accompagné une douzaine de personnes dans leurs trajets domicile-travail, à différents moments de la journée : à l’aube, tard le soir, dans les trains bondés des heures de pointe ou dans les voitures immobilisées sur l’autoroute. Le projet articule récit, dessin et analyse sociétale. Sans relever de la recherche académique au sens strict, il vise à rendre perceptibles, à travers l’expérience vécue, des réalités que la recherche met souvent en évidence sous une forme plus abstraite ou statistique.
Ce que nous avons observé, entendu et ressenti au fil de ces trajets partagés a progressivement déplacé notre compréhension du phénomène. Le trajet ne constitue pas un simple intervalle entre deux points géographiques : il mobilise des corps, des habitudes, des contraintes matérielles et temporelles, des anticipations et des émotions. Il rend visibles des inégalités souvent restées implicites, qui s’expriment dans la fatigue, le coût du logement, la marge de manœuvre plus ou moins réelle dans l’organisation du temps, l’insécurité ressentie lors des déplacements nocturnes, ou encore le choix, parfois l’absence de choix, du mode de transport. Autrement dit, le temps de trajet n’est ni neutre ni homogène : il est socialement situé, produit par des rapports de domination et façonné par des infrastructures et des politiques publiques.
Cet article prolonge la réflexion du livre en proposant une lecture du temps de trajet au Luxembourg comme un enjeu social et politique à part entière. Chaque jour, des milliers de personnes, résidentes ou frontalières, consacrent une part significative de leur journée à se rendre au travail et à en revenir. Ce temps ne relève ni du travail rémunéré, ni du repos, ni du loisir ; il constitue un temps intermédiaire, rarement comptabilisé, mais lourd de conséquences sur l’organisation de la vie quotidienne, sur la santé physique et psychique, sur la disponibilité affective et sur la possibilité même de participation sociale.
Le temps de trajet n’est pas reconnu comme du travail : on n’y produit ni biens ni services, et l’on n’est pas censé être à la disposition de son employeur. Pourtant, il ne s’agit pas non plus d’un temps libre : il est contraint, orienté, et rarement appropriable. Ses marges d’usage se limitent à quelques gestes comme fermer les yeux dans un train, lire quelques pages, écouter la radio en voiture, passer un bref appel à un proche. Cette ambiguïté, relevée par Dujarier (2021), entre temps de travail et temps de vie, apparaît clairement lorsque l’on constate que les accidents survenus pendant ces trajets sont souvent reconnus comme des accidents du travail. Elle révèle la porosité de ce moment, pris entre obligation et autonomie, entre sphères privée et professionnelle. Les déplacements prescrits dans le cadre salarial mettent ainsi à l’épreuve la définition même de ce que l’on appelle « travail ».
Inégalités temporelles et hiérarchie du temps

© Charl Vinz, Temps de trajet
Lorsqu’on examine plus finement ce qui distingue les différentes situations sur le terrain, le constat devient clair : tous les trajets ne se valent pas. La différence ne tient pas seulement à la distance mesurée en kilomètres ou en minutes, mais à la capacité de négocier, de moduler, de maîtriser son temps. Dans les métiers où une certaine autonomie organisationnelle existe, souvent les métiers dits « de bureau », il est possible de prévenir un retard, de déplacer un rendez-vous, de compenser en fin de journée, de décaler son départ avant ou après les heures de pointe. Quelques minutes d’élasticité temporelle peuvent suffire à ne pas courir, à ne pas comprimer la vie privée autour de calendriers serrés, à ne pas perdre de sommeil.
À l’inverse, dans les métiers où la présence physique est indispensable comme par exemple le nettoyage, le commerce, la logistique, la sécurité, la restauration, l’industrie ou les soins, la ponctualité est non négociable. Ici, arriver en retard n’est pas seulement un problème d’organisation : c’est une faute, une rupture du contrat professionnel implicite. « Payer » la ponctualité signifie partir plus tôt, attendre parfois longtemps sur place, renoncer à des heures de repos, réduire les moments familiaux, les loisirs, l’engagement civique. La contrainte temporelle y est plus serrée, plus impérieuse. La hiérarchie des emplois se traduit ainsi en hiérarchie du temps : en général, plus on occupe une position élevée, plus le temps est flexible ; plus on se situe dans des métiers d’exécution ou de service, plus le temps est rigide et imposé.
Le contexte luxembourgeois accentue ces dynamiques. Les derniers chiffres du Statec indiquent qu’au 1ᵉʳ janvier 2025, près de 47 % des emplois étaient occupés par des travailleurs frontaliers (Statec, 2025). Les distances moyennes reflètent ce phénomène : environ 16,7 km pour les résidents, contre 44,7 km pour les frontaliers français, 48 km pour les frontaliers allemands et 53,9 km pour les frontaliers belges. À peine un quart des actifs travaillent encore dans leur commune de résidence, signe d’un découplage structurel entre lieux de vie et lieux d’emploi (Gouvernement du Luxembourg, 2025). Ces chiffres ne traduisent pas seulement des kilomètres : ils traduisent en heures soustraites aux autres dimensions de l’existence. Le rapport BetterWork (CSL, 2025) met en évidence l’impact déterminant du temps de trajet sur la satisfaction au travail, ainsi que les écarts persistants entre résidents et frontaliers. Alors que 62 % des salariés vivant au Luxembourg mettent moins de trente minutes pour se rendre au travail, la majorité des frontaliers doivent parcourir des distances nettement plus longues. Les frontaliers français sont les plus touchés : 66 % d’entre eux déclarent un trajet supérieur à 46 minutes, contre 53 % des Belges et 52 % des Allemands. Ces différences se traduisent directement dans le ressenti : 60 % des résidents se disent satisfaits ou très satisfaits de leur trajet, tandis que près de la moitié des frontaliers français (48 %) et une proportion importante de Belges (39 %) et d’Allemands (31 %) jugent leur temps de déplacement insatisfaisant. Ces données confirment que la distance domicile-travail ne constitue pas seulement une contrainte logistique, mais une dimension centrale des inégalités de qualité de vie et de travail.
La pandémie de COVID-19 a temporairement reconfiguré les temporalités quotidiennes, en suspendant pour beaucoup la contrainte du trajet domicile-travail. Mais cette transformation est restée inégale et fragile. Cinq ans après, le retour au présentiel s’explique à la fois par les contraintes fiscales limitant le télétravail transfrontalier à 34 jours par an et par une culture d’entreprise valorisant la cohésion d’équipe. Selon la Fondation IDEA (2025), environ 20 % des salariés résidant au Luxembourg télétravaillent encore plusieurs fois par semaine, contre seulement 3 % des frontaliers, freinés par des incertitudes fiscales et sociales persistantes.
Les effets du temps de trajet sur la vie quotidienne

© Charl Vinz, Temps de trajet
Les effets des trajets longs sur la santé et la vie familiale sont largement documentés. Au-delà de 30 minutes par trajet, le stress augmente, la fatigue s’accumule, le sommeil se dégrade et le bien-être général diminue (Eurofound, 2020). Au Luxembourg, les indicateurs de conciliation entre vie professionnelle et vie privée se sont d’ailleurs détériorés depuis 2016, atteignant un point bas en 2020–2021 avant une légère amélioration. Les données les plus récentes montrent que pour 58 % des personnes interrogées, l’absence de conflit entre travail et vie privée constitue désormais la norme (QoW, 2023). Les trajets quotidiens demeurent pourtant des multiplicateurs de contraintes : ils réduisent la disponibilité mentale et limitent la capacité à s’engager socialement, politiquement ou culturellement.
Il ressort de Temps de trajet que les rapports de genre traversent profondément les expériences de déplacement. Pour beaucoup de femmes, le trajet commence avant leur propre trajet : il y a celui de leurs enfants, les détours liés aux écoles, aux crèches, ou aux courses du foyer, autant de déplacements du « care » qui précèdent ou prolongent le travail rémunéré. Ces enchaînements contribuent à allonger la journée effective et à réduire les marges de repos. Ensuite, dans les métiers majoritairement féminins, tels que le nettoyage ou le soin, les horaires atypiques, tôt le matin ou tard le soir, exposent à des conditions de déplacement plus risquées. Les retours se font souvent dans des espaces peu fréquentés ou mal éclairés, où la peur du harcèlement et de l’agression devient une dimension ordinaire du trajet. Comme le rappellent Cinatl et Schön (2025), la sécurité sur le chemin du travail reste un angle mort des politiques d’égalité. Leur étude menée dans le cadre du projet Safer Place révèle que 52 % des femmes interrogées ont déjà subi une forme de harcèlement ou d’agression dans les transports publics, le plus souvent sous forme de regards insistants, de commentaires sexistes ou d’attouchements non désirés. Ces violences ne surviennent pas uniquement la nuit : elles peuvent aussi se produire en plein jour, dans les bus, trains ou zones d’attente. Cette insécurité vécue pèse lourd sur la liberté de circulation et sur la santé psychique des femmes, et renforce les inégalités d’accès à l’emploi.
Face à ces constats, les politiques publiques de mobilité ont indéniablement progressé : gratuité des transports depuis 2020, extension du tram, investissements dans le rail. Ces mesures ont déjà produit des effets mesurables là où l’offre est fréquente, fiable et lisible. Mais ces avancées demeurent parcellaires, et dans la pratique quotidienne, les transports collectifs ne rivalisent pas encore avec la voiture en termes de temps, de souplesse et d’accessibilité.
Entre politiques de mobilité et réalités sociales

© Charl Vinz, Temps de trajet
Le Luxembourg ne s’est pas engagé dans une logique véritablement dissuasive envers la voiture : les autoroutes sont gratuites, le stationnement d’entreprise courant, les voitures de fonction fiscalement attractives. Pour de nombreux salariés, notamment ceux aux horaires atypiques, aux revenus modestes ou vivant loin des pôles d’emploi faute de logement abordable, la voiture n’est pas un confort, mais une contrainte nécessaire. Dans ce contexte, toute politique de restriction de l’usage automobile, sans alternative crédible et adaptée aux réalités de terrain, risquerait de sanctionner les plus précaires plutôt que de transformer les pratiques.
La mobilité douce s’inscrit dans la même logique : elle ne peut être réduite à une injonction individuelle. Marcher ou pédaler suppose des conditions matérielles concrètes, distances raisonnables, infrastructures continues, éclairage, sécurité, vestiaires, temps disponible. Les campagnes de sensibilisation, aussi vertueuses soient-elles, ne compensent pas l’absence d’aménagements adéquats. On ne choisit pas de marcher quand la route est dangereuse, ni de pédaler après dix heures de travail si le trajet est long, vallonné ou mal éclairé. Autrement dit, le problème dépasse la mobilité. Il est spatial et social : concentration de l’emploi, envolée du coût du logement, périurbanisation transfrontalière. Réduire les distances suppose d’aligner les politiques de logement, d’aménagement et de transport : densifier autour des gares et des lignes de tram, véritablement développer plusieurs centres d’influence, rapprocher l’emploi des bassins de vie et renforcer la coopération transfrontalière.
Mais le changement doit aussi venir du monde du travail lui-même. La journée de huit heures, pensée pour un autre siècle, ne tient plus face aux rythmes contemporains, aux trajets rallongés et à la porosité entre vie privée et professionnelle. Les gains de productivité accumulés depuis des décennies n’ont presque jamais été traduits en gain de temps pour les individus, mais en intensification des cadences et en extension de la disponibilité. Repenser l’organisation du travail, horaires, lieux, flexibilité réelle, réduction du temps de travail, devient indispensable pour redonner prise sur la journée. Cette réorganisation passe aussi par la remise en cause des emplois faiblement utiles ou dépourvus de sens, ces « bullshit jobs » décrits par Graeber (2018), qui occupent du temps sans produire de valeur sociale. Une société plus équilibrée ne se contente pas de fluidifier les déplacements : elle réévalue ce qui mérite de prendre du temps.
Repenser le travail et reconnaître le temps de trajet

© Charl Vinz, Temps de trajet
Les partenaires sociaux disposent, dans ce domaine, de leviers d’action concrets, dont la portée reste encore trop souvent sous-estimée. Pour agir de manière effective, il importe d’abord de nommer le temps de trajet pour ce qu’il est : un temps socialement déterminé, produit par des politiques de logement, des choix d’aménagement, des régulations professionnelles et des rapports de pouvoir. Sortir le trajet de l’angle mort de la négociation sociale constitue la première étape d’une action collective structurante. Cette reconnaissance appelle désormais des mesures précises, articulant négociation, prévention et réorganisation du travail. Parmi les leviers d’action possibles :
- Négocier les plages horaires comme mesure d’équité temporelle plutôt que comme simple faveur. Là où l’organisation le permet, élargir les marges d’arrivée et de départ, lisser les pointes ou organiser des rotations plus souples réduit la pression temporelle sur celles et ceux dépendants d’un train, d’un bus, d’un covoiturage ou d’horaires scolaires.
- Encadrer le télétravail par des critères transparents, élaborés en dialogue avec les délégations du personnel, et prévoir des compensations pour les métiers non éligibles : jours de récupération, primes de présence, participation accrue aux frais de transport, ou aménagements horaires spécifiques. Sans ces mesures, le télétravail risque d’entretenir une nouvelle fracture professionnelle.
- Intégrer la fatigue et la sécurité liées aux trajets dans la prévention des risques professionnels, notamment pour les emplois aux horaires atypiques (soins, nettoyage, logistique, restauration, sécurité). Des dispositifs concrets peuvent être négociés : navettes d’entreprise, arrêts à la demande, éclairage renforcé, vestiaires et stationnements vélo sécurisés.
- Reconnaître les déplacements inter-sites comme temps de travail effectif, notamment dans les secteurs multisites (nettoyage, gardiennage, aide à domicile, maintenance, construction). Leur invisibilisation revient à transférer sur les salariés une charge de temps non rémunérée, qui pèse surtout sur les plus précaires.
- Renforcer la production et l’analyse de données sur les trajets domicile-travail : durée médiane porte-à-porte par secteur, fréquence des accidents, qualité vécue du trajet (sécurité, confort, prévisibilité), accès réel aux alternatives de transport. Ces informations permettraient de mieux comprendre les inégalités temporelles et d’orienter les négociations là où les contraintes sont les plus fortes.
- Explorer des pistes sectorielles, comme dans le nettoyage avec la pratique du day-time cleaning, déjà encouragée par UNI Europa, la fédération syndicale européenne regroupant une cinquantaine d’organisations du secteur. Cette réorganisation, expérimentée par plusieurs entreprises, déplace une partie du travail vers les heures ouvrables, réduit les déplacements nocturnes et améliore la conciliation entre vie professionnelle et vie personnelle.
- Réfléchir à la durée collective du travail : lorsque la journée s’allonge d’une à trois heures de déplacement imposé, le « plein temps » déborde sur la vie entière. Réduire le temps de travail hebdomadaire ne relève pas seulement d’une revendication sociale, mais d’une politique de santé, d’égalité et de cohésion.
- Négocier des aménagements en faveur de la mobilité douce : installation de vestiaires et de stationnements sécurisés, éclairage et sécurité renforcés autour des sites de travail, indemnités vélo, participation aux plans communaux de mobilité. Ces dispositifs, négociés au plus près du terrain, rendent la marche et le vélo réellement praticables, sans transférer la responsabilité sur les individus.
Au terme de cette réflexion, une évidence se dessine : le temps de trajet fait partie intégrante de la vie sociale. Le reconnaître, c’est admettre qu’il façonne nos journées, nos équilibres et nos possibilités d’agir. Penser ce temps collectivement, c’est se donner les moyens de le rendre plus juste, plus soutenable, plus humain. Ce n’est pas un détail de l’organisation du travail, mais une dimension essentielle du travail et du vivre ensemble au sens large.
Références :
Cinatl, C., & Schön, S. (2025). (Sexualisierte) Übergriffe im öffentlichen Verkehr. Blinder Fleck Arbeitsweg. A&W Blog. Institut Arbeit & Wirtschaft. https://www.awblog.at/Frauen/Uebergriffe-im-oeffentlichen-Verkehr
Chambre des salariés. (2023). Quality of Work Index Luxembourg 2023. Luxembourg : Chambre des salariés.
Chambre des salariés du Luxembourg. (2025). BetterWork n°2 – Qualité de travail et bien-être : Quelles différences entre salariés résidents et frontaliers ? Luxembourg : Chambre des salariés du Luxembourg.
Dujarier, M.-A. (2021). Troubles dans le travail. Sociologie d’une catégorie de pensée. Paris : Presse universitaire de France.
Eurofound. (2020). Telework and ICT-based mobile work: Flexible working in the digital age. Dublin : European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions.
Gouvernement du Luxembourg. (2025). Mobilité et emploi au Luxembourg : Analyse territoriale et perspectives. Luxembourg : Ministère de la Mobilité et des Travaux publics.
Graeber, D. (2018). Bullshit Jobs: A Theory. New York : Simon & Schuster.
Lopes, J., & Vinz, C. (2025). Temps de trajet. Luxembourg : Point Nemo Publishing.
Statec. (2025). Emploi et marché du travail au 1er janvier 2025. Luxembourg : Statec.
UNI Europa. (n.d.). Daytime Cleaning Campaign. Bruxelles : UNI Europa. https://www.uni-europa.org
Image d’en-tête : © Charl Vinz, Temps de trajet