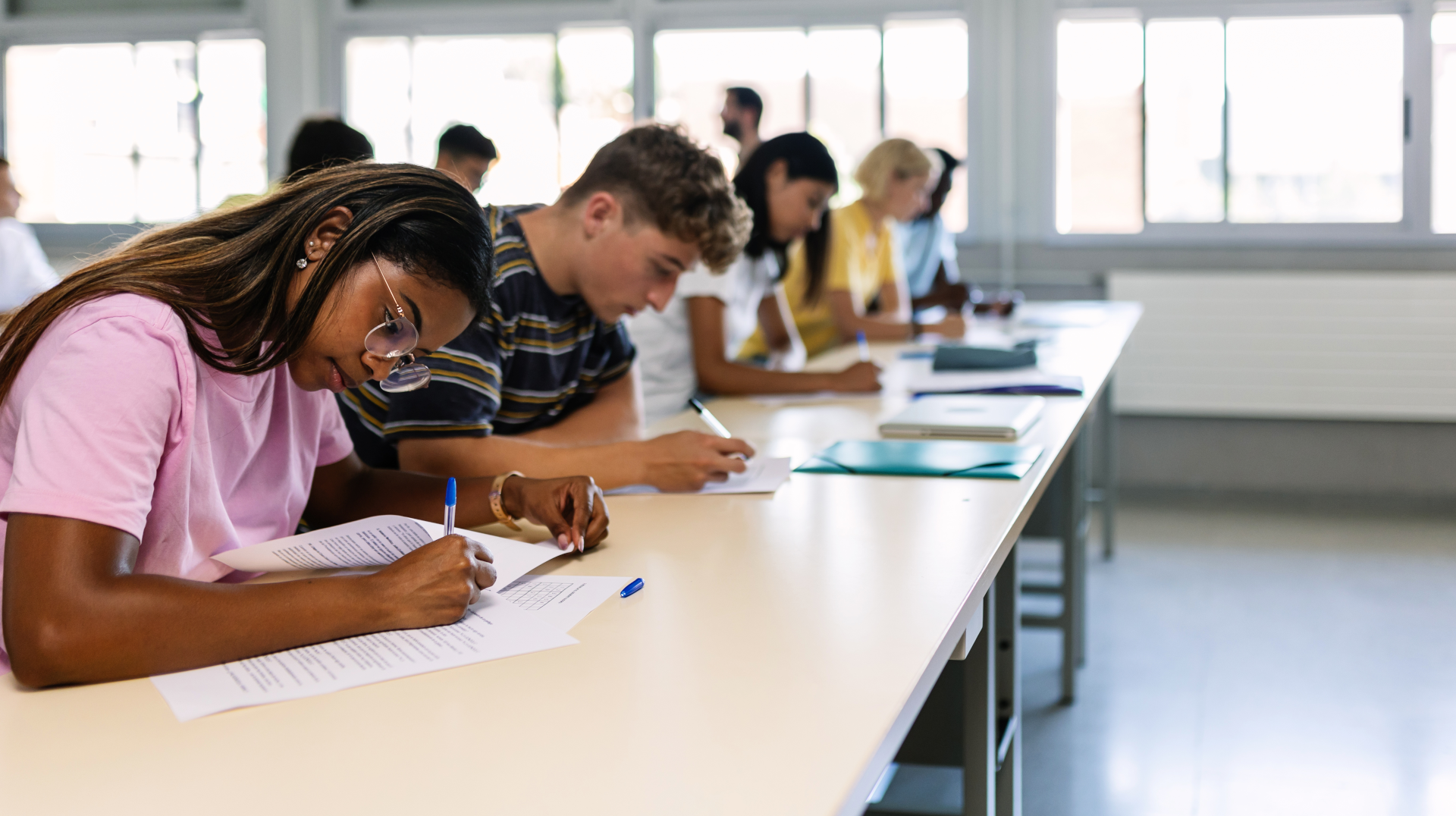Dans son ouvrage intitulé L’école des chances (2004), François Dubet affirme que le bonheur d’aller à l’école ne fait pas partie du programme scolaire. Manière, pour ce sociologue de renom, de déplorer les inégalités sociales que l’école continue à produire.
De fait, si les diverses transformations ayant bouleversé les structures et le fonctionnement du système éducatif luxembourgeois ne suffisent pas, à elles seules, à expliquer les inégalités scolaires et sociales, elles restent néanmoins déterminantes dès que l’on envisage les phénomènes de déclin scolaire et les diverses analyses de ce dernier.
D’ailleurs, le Rapport national sur l’éducation de 2024, souligne avec force que « les inégalités sociales sont et restent un défi pour le système éducatif luxembourgeois ». Et d’ajouter que « les réformes existantes et futures devraient mettre l’accent sur les élèves particulièrement touchés par les inégalités dans le système scolaire » (LUCET[1], 2024). Allant dans le même sens, la directrice du LUCET rappelle que « 82,3% des étudiants doivent en outre surmonter la complexité linguistique de notre système » (ibid.).
Face à ces allégations, l’on peut se demander si les travaux entrepris par le ministère de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse (Menje) ont réellement pris en considération la situation des élèves les plus affectés par ces inégalités scolaires.
Cette question mérite d’autant plus d’être posée que la « reproduction scolaire[2] » – phénomène mis en lumière par le sociologue Pierre Bourdieu dès 1970 – constitue la base méthodologique de nature systémique sur laquelle repose le réapprovisionnement en continu de ce que l’on peut qualifier de « fonds de commerce » de l’école luxembourgeoise.
En effet, en montrant comment les habitus sociaux et les capitaux culturels transmis dans les familles sont reconduits par l’institution scolaire sous l’apparence d’un mérite neutre, Pierre Bourdieu a mis au jour les mécanismes subtils par lesquels l’école légitime et perpétue l’ordre social existant.
Aujourd’hui, le Menje déplace son investissement vers « la pensée digitale » (Menje, 2023) qui, bien que présentée comme fondamentale, n’efface, ni n’atténue, ni ne permet de passer outre les inégalités scolaires.
Partant de ces constats, nous proposons d’analyser en quoi la persistance et, au-delà, l’aggravation des inégalités nécessitent une révision de la manière dont le système scolaire luxembourgeois peine à accueillir des élèves dans toute leur diversité et à leur permettre d’accéder à des diplômes facilitateurs d’entrée dans la vie active.
1. Les inégalités scolaires au Luxembourg
Les chercheurs de l’Université du Luxembourg ont étudié les inégalités produites par l’école et le rôle de celle-ci dans la reproduction sociale « à l’aune des différences liées aux considérations socioéconomiques, au sexe et au contexte migratoire » (MEN, 2023). Cependant, ces thématiques qui délimitent les conditions possibles de la naissance d’inégalités scolaires, nous semblent discutables dans le contexte présent, de par leur partialité.
En effet, l’on ne peut se fonder sur ces bases pour interroger et comprendre les processus aboutissant aux inégalités scolaires, attendu que les causes de ces dernières sont à la fois multiples et, bien souvent, en interaction. En atteste le concept de capital culturel mis en avant par Pierre Bourdieu. En cela, il paraît donc nécessaire de s’appuyer aussi sur d’autres éléments et, plus précisément, sur ce qui est consciemment et inconsciemment reproduit dans l’institution scolaire.
Afin de saisir l’idée bourdieusienne, rappelons que, « dans une société où la transmission culturelle est monopolisée par une école, les affinités souterraines qui unissent les œuvres humaines (…) trouvent leur principe dans l’institution scolaire, investie de la fonction de transmettre consciemment (et aussi, pour une part, inconsciemment) de l’inconscient ou, plus exactement, de produire des individus dotés de ce système de schèmes inconscients (ou profondément enfouis) qui constitue leur culture » (Bourdieu, 1967, p. 374).
Dans ce passage, réside sans doute la pierre angulaire des inégalités scolaires. Néanmoins, d’un point de vue institutionnel, cette même pierre ne suffit pas à expliquer la situation très singulière de l’école luxembourgeoise où les inégalités se développent et se perpétuent avec ampleur et obstination. Raison pour laquelle, c’est logiquement la nature même du système éducatif qui doit être étudiée.
2. Un système éducatif non équitable
Les programmes scolaires nés des politiques éducatives ne concernent pas seulement la question de la transmission des savoirs, de l’apprentissage d’une culture ou de la propagation de valeurs et de normes scientifiques et sociales. L’école contribue aussi, et au-delà, à reproduire les structures mêmes de l’organisation sociale, politique et économique d’une société donnée.
Sur ce point, l’Observatoire national de la qualité scolaire (ONQS), dans sa publication intitulée Orientations pour une réduction de l’impact des inégalités d’origine sociale dans le système éducatif (2022), dresse le même constat que l’Université du Luxembourg a soulevé en 2021, à savoir que « le système éducatif du Grand-Duché reste marqué par une forte continuité des inégalités scolaires » (p.93). L’ONQS en conclut que « dans une perspective d’égalité des chances et d’équité sociale, il y a lieu de constater une situation globalement insatisfaisante en raison du fort ancrage, voire du creusement des inégalités scolaires » (2022, p. 153).
À ce stade, l’on retiendra donc que le modèle sociopolitique et éducationnel de l’école luxembourgeoise travaille, depuis les années 60, à ce que la répartition inégale des biens scolaires conduise un grand nombre d’élèves à l’échec, attendu que ces « inégalités scolaires générées par les origines socioéconomiques et socioculturelles des élèves [et de leurs parents] […] ont un effet systémique et peuvent être récurrentes [aboutissant ainsi à une reproduction des inégalités] » (ONQS, p.94).
En 2008 déjà, les travaux menés par les chercheurs de l’Université du Luxembourg, présentés dans l’ouvrage intitulé La place de l’école dans la société luxembourgeoise de demain, avaient parfaitement cerné la dimension reproductive des politiques éducatives. Cette étude montrait que « le système scolaire luxembourgeois, est, au départ, une École faite par les Luxembourgeois pour les Luxembourgeois » (p. 66).
Les auteurs soulignent aussi que « ce phénomène national est bien l’œuvre de « l’État-providence conservateur-corporatiste luxembourgeois [qui] exerce une grande influence sur les mécanismes de construction et de reproduction de l’identité nationale luxembourgeoise et sur les mécanismes de fonctionnement du système scolaire national » (ibid.).
Depuis lors, le constat est sans appel : « Aucun effort significatif n’a été entrepris pour changer les mécanismes sous-jacents de ce système largement inadapté à la situation luxembourgeoise contemporaine » (p. 66). Au point que, comme le souligne l’ONQS : « Le système éducatif luxembourgeois reste particulièrement discriminatoire [pour les élèves non-luxembourgeois] (…) et qu’une forte stratification de la population scolaire et une forte ségrégation au sein du système scolaire font que le Luxembourg ne fait pas partie des pays affichant les caractéristiques d’un système éducatif équitable et juste » (ONQS, pp. 11 et 35).
En effet, « plusieurs éléments de fonctionnement – dont (…) les critères d’évaluation, d’orientation et donc de sélection non transparents et implicites qui sont utilisés dans les écoles – favorisent une grande homogénéisation de la population scolaire » (ibid.,p.65). D’un côté, « les élèves luxembourgeois de classe moyenne » profitent largement de celle-ci, car ils « ne sont pas exclus du cursus « normal ». Ils se retrouvent massivement dans le secondaire dit « classique ». Tandis que, de leur côté, les élèves issus de l’immigration, ont beaucoup plus de chances de redoubler au moins une fois dans le primaire. En conséquence de quoi, au travers d’une « sélection et orientation par l’échec », ceux-ci se retrouvent très souvent dans le secondaire technique et, plus souvent encore, dans le régime préparatoire nommé « le modulaire », filière la moins valorisée du système scolaire » (p.65).
Ce constat est d’autant plus inquiétant que les décideurs politiques ne cessent depuis de nombreuses années de légitimer l’école au nom de l’égalité pour tous. L’ONQS rappelle qu’« au niveau politique, l’égalité des chances a fait partie intégrante des réformes majeures entreprises au cours des 20 dernières années, notamment dans l’enseignement fondamental (2009), l’enseignement secondaire (2017) et la formation professionnelle (2008/2019) » (ONQS, 2022[3], p.45).
Confirmant cette volonté, le Rapport national sur l’éducation de 2021 affirme que « les inégalités scolaires constituent un problème persistant, systémique et dynamique du système éducatif luxembourgeois ». Au point d’être considérées comme « une priorité parmi d’autres de la politique éducative et de la pratique pédagogique » (p. 45). À quoi l’on peut ajouter que « les parties prenantes du système éducatif se déclarent naturellement sensibles à la question des inégalités scolaires et s’investissent en faveur d’une amélioration des conditions d’apprentissage et d’enseignement des élèves à faible statut socioéconomique (ibid.).
Cette question est d’autant plus essentielle que pour la sociologue Marie Duru-Ballat, les « zones d’ombre eu égard aux inégalités sociales à l’école » (2009) témoignent de la fragilité excessive de notre système éducatif et de notre société moderne. Pour mieux l’expliquer, la persistance des inégalités scolaires et sociales dans l’école luxembourgeoise apparaît, donc, de facto, comme la résultante d’une construction sociale de « l’État-providence conservateur-corporatiste luxembourgeois » dont « la dimension sociétale ou plutôt socio-politique et la dimension éducationnelle sont, en effet, fortement entrelacées » (Martin, Dierendonck & al., 2008).
Il en résulte que ces « mécanismes de construction et de reproduction de l’identité nationale et, plus largement, l’influence du modèle conservateur-corporatiste » (ibid.) exercent un impact considérable sur le fonctionnement du système scolaire luxembourgeois. Cette persistance apparaît comme la résultante d’un système qui ne peut évoluer sans une remise en question de ses fondements. Observés sous cet angle, ces mécanismes d’entrelacement qui commencent dès l’école fondamentale et qui bâtissent « une société [scolaire] divisée en classes », apparaissent comme le facteur principal de reproduction du principe de « sélection arbitraire ».
Sur le plan sociopsychologique, le LISER (2021)[4], rappelle que ce processus de sélection des élèves est discriminatoire. Il peut déclencher chez les élèves non-luxembourgeois qui en sont victimes « un sentiment de honte face à ces événements ressentis comme un déclassement, un sentiment d’exclusion, l’impression de ne plus appartenir à un groupe quand successivement toutes les portes se ferment et qu’ils ne trouvent plus d’alternatives. Le jeune n’est plus un élève, il n’est pas un travailleur, il n’est pas un chômeur » (p. 51).
Or, ces mécanismes de reproduction engendrent bien souvent, dans cette population, des situations d’échec scolaire, voire de décrochage scolaire. Les déclarations du ministère de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse à cet égard sont sans équivoque : « Beaucoup de jeunes qui abandonnent l’école ne rejettent pas l’école, mais ont plutôt le sentiment que c’est l’école qui les rejette[5] » (2022).
Pourtant, les méfaits du sentiment de rejet éprouvé par certains jeunes ne semblent pas être pris en compte à leur juste mesure par le ministre concerné.
De fait, celui-ci propose de dérouter le système éducatif et de « créer des voies alternatives pour rendre les jeunes plus forts et leur permettre de terminer leur scolarité » en reculant l’âge de la scolarité obligatoire. L’idée sous-jacente étant que le fait de maintenir un jeune plus longtemps dans le système scolaire le motiverait à obtenir des qualifications supplémentaires et limiterait le nombre de non-diplômés.
Cette approche ne nous semble en rien pertinente, car allonger la scolarité obligatoire jusqu’à l’âge de 18 ans ne fait que confronter, durant un laps de temps plus long, les élèves concernés aux mêmes difficultés. Ce qui aboutit à davantage d’absentéisme scolaire ou de décrochage scolaire. En cela, cette mesure ne résout pas et ne peut pas résoudre « la question plus ancienne et plus générale de l’échec scolaire (qui s’était imposée avec la généralisation de l’accès à l’enseignement secondaire dans les années 60 et 70) » (Peyronie, 2014).
D’ailleurs, cette proposition politique rencontre une forte résistance. D’une part, des études réalisées sur les bienfaits d’une telle politique soulignent la nécessité que cette scolarité prolongée soit accompagnée d’autres mesures éducatives (ibid., p.64). D’autre part, les rapports du Menje soutiennent cette réforme, mais en légitimant la mise en place d’une politique éducative linguistique, à la maîtrise de la langue luxembourgeoise. Cette dernière est considérée comme l’essence de la culture luxembourgeoise et confortée, au sein du langage du politique, comme le « pilier de notre société » (Menje[6], 2023). Cette configuration est significative du caractère systémique de l’échec des politiques éducatives. Le luxembourgeois constitue un patrimoine linguistique et culturel à sauvegarder.
Toutefois, un certain flou terminologique entoure le terme « luxembourgeois » au sens de langue parlée au Luxembourg. Une imprécision qui, pour la psychologue sociale Denise Jodelet (1993), montre que la réalité est construite de manière à fabriquer des « représentations sociales ».
En somme, l’important est que le Grand-Duché soit, du moins sur papier, un État plurilingue dont le système éducatif repose sur la multinationalité et le trilinguisme (allemand, français, luxembourgeois). Et ce, quand bien même ce trilinguisme ne concerne qu’une part réduite et privilégiée de la population.
Or, n’oublions pas que « toute représentation est organisée autour d’un noyau central » (Abric, p.28) dont se réclament les aspirations nationales proclamées. Partant de là, ce symbole identitaire et culturel national ne constitue-t-il désormais pas un modèle de « nationalisme linguistique », inadapté « à la composition sociologique et au contexte actuel » du pays ? (d’lëtzebuerger Land, 2015).
Cet exemple montre le type d’engrenage dans lequel les politiques éducatives se trouvent prisonnières et le caractère systémique des entraves mises à toute action visant à lutter contre l’échec scolaire. Au-delà, il met en relief ce qui conduit à l’échec méthodique de ces politiques.
Un échec d’autant plus normalisé que le Luxembourg est confronté à un dilemme cornélien : soutenir la construction de l’identité luxembourgeoise avec, en son cœur, la langue luxembourgeoise, (quand bien même un tel système favorise les mécanismes de production et de reproduction susmentionnés, lesquels institutionnalisent les inégalités et, par conséquent, l’échec scolaire d’une partie des jeunes non-luxembourgeois), ou bien remettre en question les fondements de l’identité luxembourgeoise et de son système éducatif.
Si l’on détermine le point d’observation à partir duquel analyser les éléments, tout tend à croire ce que le sociologue François Dubet (2019) soulève « on ne « voit » pas et on ne mesure pas les mêmes inégalités selon que l’on se place du point de vue de l’égalité des chances ou du point de vue de l’égalité des résultats. [Or], en fonction de ces conceptions de la justice, on ne propose pas les mêmes solutions et les mêmes politiques » (p. 113).
Fondée sur « les faits saillants des parcours scolaires » (ibid., p. 64), cette typologie creuse inévitablement « un fossé social dans le système éducatif luxembourgeois, tandis que les écarts de performance entre les groupes d’élèves s’amplifient ». En effet, « les résultats actuels montrent que le système éducatif luxembourgeois n’apporte pas de réponses adéquates à la diversité sociale du pays. […]. En outre, les élèves issus de foyers socioéconomiquement défavorisés, ne parlant aucune des langues d’enseignement à la maison ou fréquentant l’une des deux filières de l’enseignement secondaire général (ESG) sont particulièrement vulnérables dans le système scolaire luxembourgeois » (Rapport national sur l’éducation, 2021, p. 12).
Ces éléments soulignent l’importance que c’est à la fois l’égalité des chances et celle des résultats qu’il faut mettre au travail, sans les opposer l’une à l’autre, mais en les intégrant dans une même logique d’inclusion, laquelle nécessite de consolider, voire de réenvisager les piliers du système éducatif actuel.
3. Une politique linguistique qui peut exclure
Le dernier enjeu concerné par cette thématique est celui de l’accès à l’information qui, lui aussi, devient inégalitaire en dépit du rôle central que cet accès joue dans la participation citoyenne à la vie démocratique.
Cette tendance de plus en plus remarquée se dessine au niveau de la communication de part du Menje qui est celle de privilégier la langue luxembourgeoise dans ses communications ministérielles et publications officielles. L’exemple de publication ci-dessous[7], présentée exclusivement en langue luxembourgeoise sur le site officiel du ministère du Menje, répond au projet ambitieux de promouvoir le multilinguisme dès le premier cycle. Néanmoins, elle soulève plusieurs interrogations quant à son public réellement visé.
Meng Sprooch(en), deng Sprooch(en), eis Sprooch(en): Sproochlech Bildung am éischte Cycle
Entwécklung vu mëndleche Kompetenzen am Lëtzebuergeschen, Eruféierung un déi geschwate franséisch Sprooch, Wäertschätzung an aktiivt Abezéie vun den Éischtsprooche vun de Kanner, doniewent éischt Schrëtt op dem Wee an déi geschriwwe Sprooch: Esou léisst sech de sproochleche Bildungsoptrag vum éischte Cycle graff resüméieren. D’Haaptuleies vum Recueil „Meng Sprooch(en), deng Sprooch(en), eis Sprooch(en) – Sproochlech Bildung am éischte Cycle“ ass et, fir ze weisen, wéi dëse kann ëmgesat ginn.
D’Konzeptioun vu sproochlecher Bildung, déi an dësem Recueil virgestallt gëtt, presentéiert sech an dräi Deeler. Jiddwer Deel gëtt a Form vun engem Heft presentéiert:
Deel 1: Sprooch a Sproochen zu Lëtzebuerg
Deel 2: D’Kand a seng Sprooch(en)
Deel 3: Sprooch a Sproochen am éischte Cycle[8]
Cette publication met en avant le développement du luxembourgeois oral, l’introduction du français parlé, ainsi que la « valorisation » des langues premières des enfants. Pourtant, l’on peut se demander dans quelle mesure cette approche répond véritablement à la diversité linguistique présente sur le terrain. Autrement dit, à quels élèves profite cette publication concrètement ?
Dans un contexte marqué par une grande diversité linguistique et culturelle, ce constat semble implicitement viser un profil d’élèves déjà familiarisé au luxembourgeois. Alors que, simultanément, l’institution maintient indirectement à la marge, celles et ceux dont les langues familiales ne sont intégrées qu’en théorie. Or, ne risque-t-on pas de reproduire voire d’institutionnaliser, une inégalité des chances dès les premières années de scolarité ?
De plus, nous estimons que l’absence d’une véritable politique éducative et d’une prise en compte des besoins concrets des élèves allophones et de leurs familles – sous l’apparence d’une « participation citoyenne [voire inclusive] à la vie démocratique pour renforcer le vivre-ensemble[9] » – risque de renforcer les inégalités déjà existantes plutôt que de les réduire.
Un avis qui se justifie d’autant plus que, sur le site officiel du Menje, aucune traduction de cette publication n’est accessible, alors même que celui-ci affirme garantir une communication en quatre langues. Cette contradiction illustre parfaitement le décalage entre la volonté politique affichée et la réalité de l’accès équitable à l’information pour tous.
Dans cet exemple, les parents d’élèves qui ne maîtrisent pas suffisamment le luxembourgeois, se trouvent ainsi écartés d’une communication ministérielle. Or, sur un plan systémique, une telle exclusion linguistique affaiblit le lien entre l’école et les familles, freine l’implication des parents et accentue toutes formes d’inégalités sociales. Plus largement, si l’accès à l’information devient un privilège linguistique plutôt qu’un droit universel, comment garantir la cohésion sociale et préserver le vivre ensemble ?
Au vu des questionnements soulevés, nous soutenons que le choix de ne publier qu’en luxembourgeois certains textes officiels, (dont ceux en lien avec l’enseignement fondamental), constitue un facteur d’exclusion pour une partie de la population – en particulier les familles issues de l’immigration, qui ne maîtrisent pas cette langue. Ce choix linguistique, qu’il soit volontaire ou non, prive ainsi des catégories entières de citoyens d’informations, les excluant dans les faits des débats, services ou autres dispositifs éducatifs et sociaux.
En cela, si le choix quant à la langue de présentation de ce texte constitue un symbole fort d’affirmation nationale, il n’est pas sans soulever un paradoxe. En effet, alors que l’État affirme vouloir renforcer l’identité luxembourgeoise, ce renforcement s’appuie sur des facteurs de division et non pas de rassemblement. Pourtant, une identité inclusive ne peut se construire qu’au travers d’une politique linguistique ouverte qui reconnaît et valorise la diversité culturelle du pays.
4. Vers une reproduction sociale des inégalités
En évitant ou en restreignant l’accès à l’information, l’incompréhension entraîne une exclusion linguistique qui participe à une forme de ségrégation scolaire et sociale. Ce faisant, on affaiblit les ponts entre les différentes communautés ce qui, in fine, compromet le vivre ensemble.
Ainsi, non seulement l’accès à l’information s’en trouve déséquilibré dans le cadre scolaire, mais en outre, l’implication des parents dans la scolarité de leurs enfants peut être grandement affectée. Si les parents ne peuvent pas accompagner ou comprendre les démarches liées à l’école, l’intégration de leurs enfants sera réduite et les écarts de réussite seront accentués.
Pour toutes ces raisons, ce phénomène va à l’encontre des principes d’égalité des chances et compromet, de manière directe, la cohésion sociale. Il est donc à la fois urgent et proprement fondamental de repenser la politique éducative afin que celle-ci puisse réellement servir la cohésion sociale, en garantissant à tous les citoyens – quelle que soit leur langue maternelle – un accès équitable à l’information et à la participation démocratique.
5. L’enjeu d’une identité luxembourgeoise partagée
La construction de l’identité luxembourgeoise ne doit pas se faire au détriment de l’inclusion. Il est possible d’affirmer cette identité tout en adoptant une politique linguistique plus ouverte, en proposant des traductions systématiques dans les langues les plus parlées par les familles immigrées. Une telle politique contribuerait à renforcer le sentiment d’appartenance et à favoriser une société plus intégrée et équitable.
Dans son dossier de presse de la rentrée scolaire 2021-2022, le Menje a affirmé aux élèves : « Hei kanns du wuessen. Plaz fir staark Kanner »[10]. À l’aune de ses effets, le langage politique adressé aux élèves, rarement questionné, gagnerait à être repensé car quid des enfants qui ne sont pas forts et quid de ceux qui ne pourront pas le devenir ? Plus concrètement, il s’agit de faire une place véritable à tous les élèves, y compris les plus fragiles, et d’éliminer les inégalités persistantes, largement mises en avant par de nombreuses instances luxembourgeoises.
En définitive, chaque élève mérite « son » école luxembourgeoise – une école dans laquelle il pourra se rendre avec plaisir chaque jour et s’épanouir, tant socialement qu’intellectuellement. Une école qui est capable de reconnaître les singularités de tous les élèves et de lui offrir les conditions effectives d’un épanouissement scolaire et personnel. Le droit fondamental à une telle expérience scolaire, fondée sur le plaisir d’apprendre et la possibilité de réussir dans un cadre inclusif, devrait être au cœur des débats politiques sur l’éducation. Mais surtout, il devrait constituer l’axe structurant de toute politique éducative.
Or, une telle ambition suppose de rompre avec le modèle implicite d’une école dissimulant, sous l’apparence de la neutralité, les mécanismes systémiques de reproduction des inégalités sociales. En effet, comme l’ont démontré Pierre Bourdieu et Jean-Claude Passeron, (La Reproduction, 1970), loin de corriger les désavantages issus de l’origine sociale, l’école tend, selon ces sociologues, à les légitimer en les reconvertissant en mérites scolaires. En apparence, l’école sélectionne les élèves sur la base des compétences individuelles, mais en réalité, la sélection repose sur la base d’un habitus culturellement hérité, aligné sur les attentes implicites de l’institution.
Il s’agit donc de ne plus tolérer que le système scolaire luxembourgeois demeure fondé sur la reproduction sociale des élites, mais qu’il soit désormais résolument inscrit dans un projet démocratique. Ce qui suppose de penser l’école non comme un filtre ou un instrument de sélection, mais comme un espace de capacitation, de formation de soi et de transmission critique des savoirs. C’est à cette condition qu’elle pourra redevenir un lieu de justice sociale et non de reconduction des privilèges.
Bibliographie
Bourdieu, P. (1967). « Systèmes d’enseignement et systèmes de pensée ». Revue internationale des sciences sociales, XIX, 3, p. 367-388.
Bourdieu, P., & Passeron, JC. (1970). La reproduction. Les Éditions de Minuit.
Dubet F. (2004). L’école des chances. Qu’est-ce qu’une école juste ? Éditions du Seuil et La République des Idées.
Felouzis, G., Fouquet-Chauprade, B ; Charmillot, S ; Imperiale-Arfaine, L. (2016). « Inégalités scolaires et politiques d’éducation ». Contribution au rapport du Cnesco : Les inégalités scolaires d’origines sociales et ethnoculturelle. Paris. Cnesco.
LUCET (2024). Rapport national sur l’éducation, Luxembourg. https://men.public.lu/content/dam/men/fr/actualites/articles/communiques- conference-presse/2024/12/presentation-bildungsbericht-2024.pdf
Men.lu (2022). Regards de jeunes sur leur parcours de décrochage dans l’enseignement général. https://men.public.lu/fr/actualites/communiques- conference-presse/2022/02/22-obligation.html
Men.lu (2025). Rapport d’activité 2024 du ministère de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse. https://men.public.lu/fr/publications.html?q=Rapport+d%E2%80%99activit%C 3%A9+minist%C3%A8re
Peyronie, H. (2014). « La scolarité obligatoire ». Dans : Jacky Beillerot éd., Traité des sciences et des pratiques de l’éducation (pp. 207-217). Paris : Dunod. https://doi.org/10.3917/dunod.beill.2014.01.0207